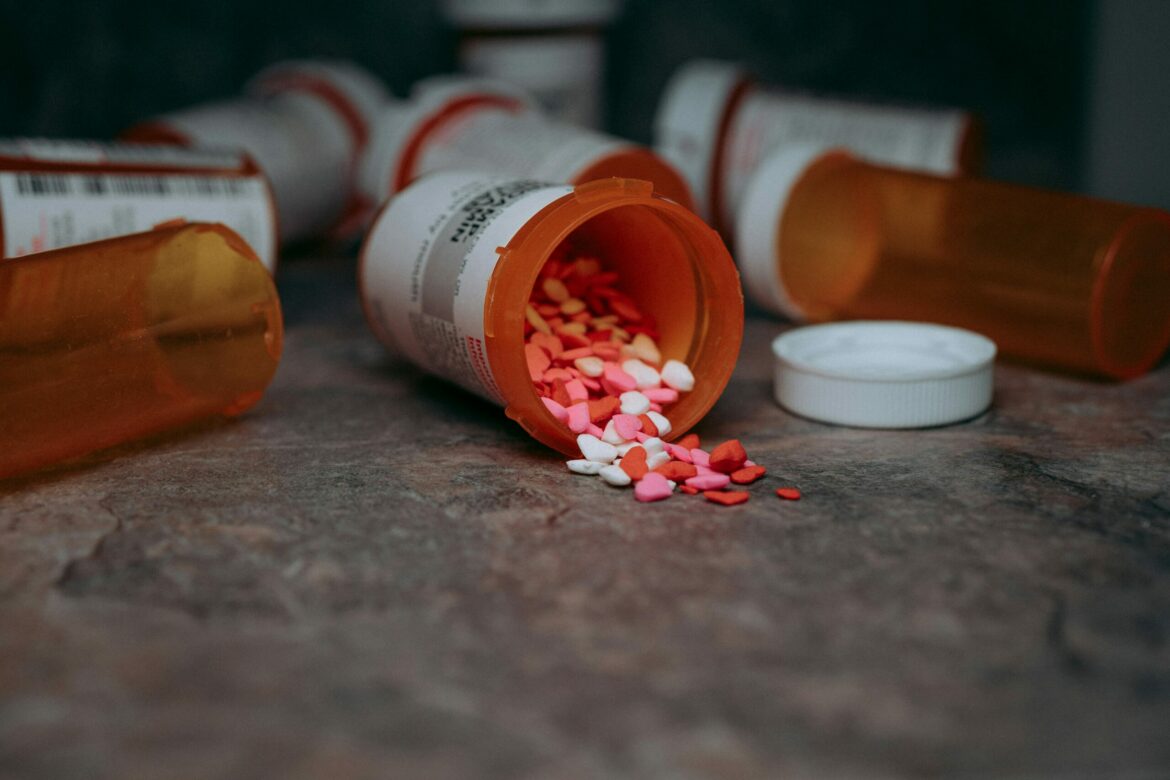
Le rapport du Sénat (n°848) dresse un état des lieux complet de la consommation d’opioïdes en France, de leurs modes de circulation et des risques émergents, tout en évaluant les stratégies de prévention et de réduction des risques actuellement mises en œuvre. Il s’appuie sur les données de l’Observatoire français des drogues et des conduites addictives (OFDT), de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM), ainsi que sur les réseaux de veille sanitaire TREND et SINTES.
Contexte international et circuits d’approvisionnement
En 2023, la production mondiale d’opium, matière première de l’héroïne, est estimée à environ 1 990 tonnes. L’Afghanistan, longtemps premier producteur mondial, a connu une chute de 95 % de sa production entre 2022 et 2023 à la suite de l’interdiction de la culture du pavot, passant de 6 200 tonnes à 333 tonnes. La Birmanie est désormais le principal pays producteur avec environ 1 080 tonnes, soit un doublement de sa production par rapport à 2021. Ces bouleversements sur le marché mondial traduisent un choc d’offre majeur susceptible d’influencer les routes du trafic et de favoriser le développement des opioïdes de synthèse.
Les analyses réalisées en France révèlent que 14 % des échantillons d’héroïne collectés en 2023 ne contenaient pas de principe actif : un signe d’adultération croissante, souvent associée à la substitution par d’autres substances, y compris des opioïdes de synthèse.
Les opioïdes de synthèse : un risque émergent
Le rapport souligne la montée en puissance des opioïdes de synthèse, notamment le fentanyl et ses dérivés, ainsi que les nitazènes, qui représentent une menace croissante pour la santé publique. Bien que leur présence demeure limitée sur le territoire français, plusieurs signaux d’alerte ont été enregistrés ces dernières années. En 2021, un premier échantillon d’héroïne contenant de l’étonitazépine a été identifié par le dispositif SINTES. En 2023, plusieurs clusters d’intoxications aiguës ont été détectés, notamment à Montpellier et à La Réunion, où des nitazènes (i-sotonitazène et protonitazène) ont été retrouvés. En 2024, la cyclorphine, un nouvel opioïde non encore reconnu dans les circuits de vérification des drogues, a été détectée pour la première fois en France.
Parallèlement, la consommation et le détournement d’opioïdes médicamenteux restent une préoccupation majeure. Entre 2006 et 2017, la prescription d’opioïdes forts tels que l’oxycodone a augmenté d’environ 150 % en France. Les opioïdes dits faibles, comme le tramadol ou la codéine, sont plus largement diffusés, mais leur usage détourné ou non conforme demeure préoccupant. Ces tendances traduisent une banalisation progressive de l’usage médical des opioïdes, qui peut favoriser des conduites de dépendance ou de mésusage.
Conséquences sanitaires et sociales
Les conséquences de cette consommation sur la santé publique sont significatives. En 2022, 136 décès ont été directement attribués à l’usage d’antalgiques opioïdes selon les données de l’ANSM. Le nombre d’hospitalisations liées à ces substances est passé de 15 à 40 pour un million d’habitants entre 2000 et 2017, soit une progression de 167 %. Sur la même période, la mortalité liée aux opioïdes a augmenté de 146 %.
L’héroïne demeure une cause importante de prise en charge dans les structures spécialisées. En 2022, près de 33 000 personnes ont été suivies dans des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) pour usage d’héroïne. Parmi elles, 57 % consommaient par voie nasale, 25 % par inhalation et 17 % par injection. La grande majorité (72 %) déclarait une consommation quotidienne et près de 80 % indiquaient une consommation commencée depuis plus de dix ans. Ces chiffres traduisent une forte chronicisation des usages et une population d’usagers relativement stable mais vieillissante.
Prévention, réduction des risques et politiques publiques
Le rapport constate une intensification des efforts de prévention et de réduction des risques, mais souligne leur hétérogénéité selon les territoires. L’accès à la naloxone, antidote des overdoses, s’est développé de manière notable : entre 2021 et 2023, les commandes de kits ont augmenté de 40 %, passant de 18 132 à près de 29 700 unités distribuées dans les pharmacies, hôpitaux et structures spécialisées. Toutefois, le rapport souligne la difficulté à mesurer l’utilisation effective de ces kits sur le terrain.
Les structures de première ligne, telles que les CSAPA et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (CAARUD), demeurent essentielles pour la prise en charge des personnes les plus vulnérables. Les salles de consommation supervisée, expérimentées depuis 2016 à Paris et à Strasbourg, ont montré des effets positifs : diminution des pratiques à risque, meilleure orientation vers les soins et réduction des nuisances publiques. Le rapport recommande d’envisager leur inscription dans le droit commun, tout en adaptant leur déploiement aux besoins locaux.
Limites et perspectives
Les auteurs du rapport rappellent que les données disponibles restent partielles et parfois anciennes. Certaines consommations, notamment clandestines ou liées à de nouveaux opioïdes de synthèse, échappent encore à la surveillance. La relation entre l’augmentation des prescriptions médicales et les phénomènes de dépendance ne peut être établie de façon stricte en raison de la diversité des sources et des méthodes de collecte.
Enfin, si la France ne connaît pas à ce jour de crise des opioïdes comparable à celle observée en Amérique du Nord, les indicateurs de consommation, d’intoxication et de mortalité invitent à renforcer la vigilance. Le rapport conclut à la nécessité d’un suivi continu, d’un encadrement plus strict des prescriptions et d’un soutien accru aux dispositifs de prévention et de réduction des risques.


